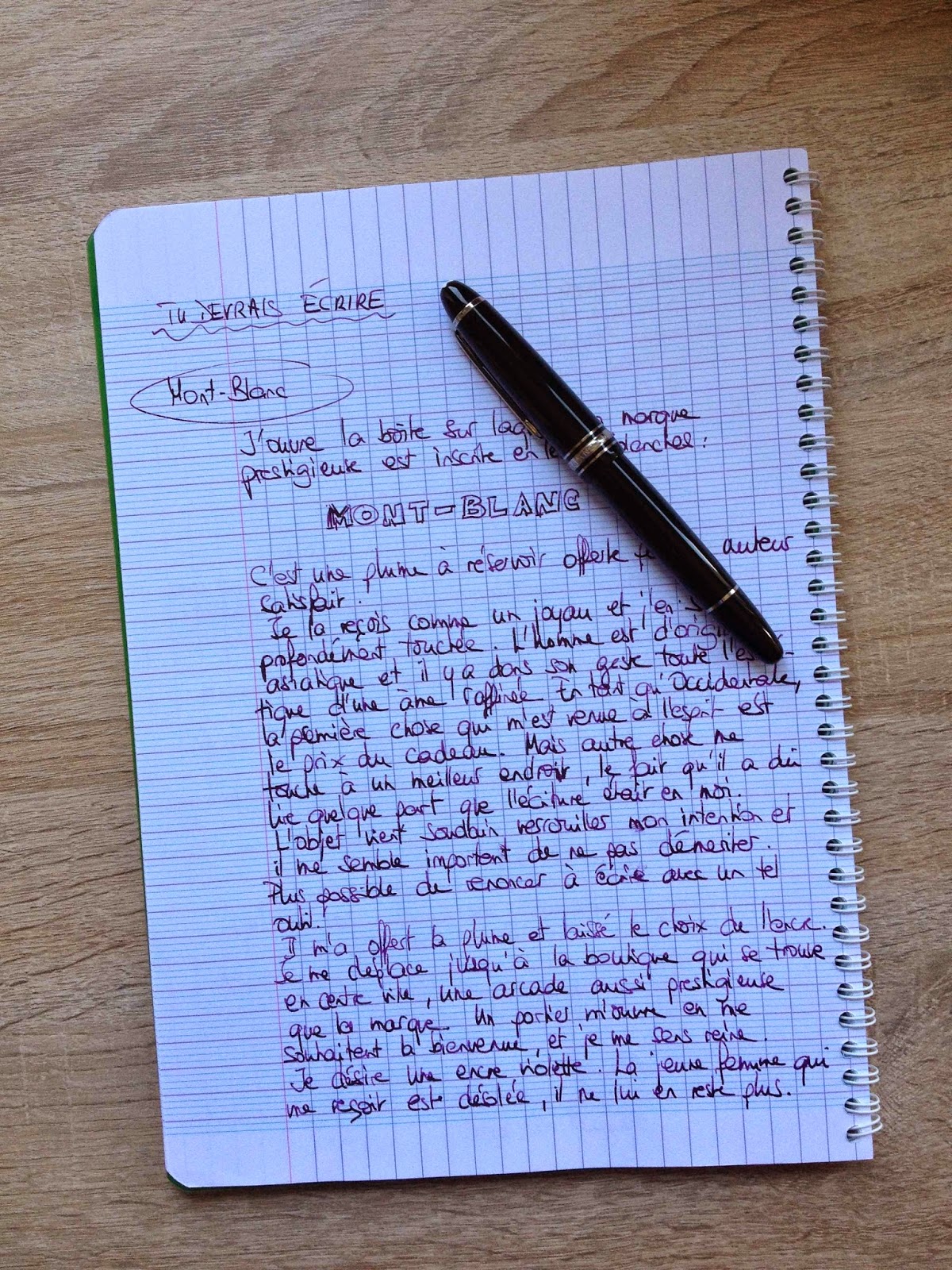TU DEVRAIS ÉCRIRE
Un épisode de grippe me cloue au lit pendant deux jours et interrompt l’écriture.
«Clouer au lit» ou «clouer au sol» pour des avions, voilà des métaphores étranges. A-t-on jamais vu un avion cloué au sol? En revanche, des clous dans mon lit, peut-être bien. J’ai de la fièvre et des courbatures, autant de petites pointes douloureuses dans mes muscles.
J’en profite pour lire les articles et visionner les vidéos marque-paginés «pour plus tard». Plus tard, c’est maintenant. Ce sont des articles sur la marche du monde. Toujours les grandes questions existentielles qui me passionnent. Qui suis-je, où cours-je, dans quel état j’erre?
Tant pis pour les jeux de mots laids, j’ai de la fièvre.
Ces questions sont en moi depuis toujours. Il me semble que je suis née avec la première qui fut : «Mais qu’est-ce que je fais là?» On m’a souvent dit de ne pas chercher la réponse et j’ai posé une autre question : «Pourquoi?» On ne m’arrêtera pas.
À l’adolescence je me demandais à quoi servait la vie. Les réponses furent si peu satisfaisantes que j’ai caressé, pendant quelques temps, un projet de suicide. C’était de la logique et non du désespoir. Si vraiment il n’y a rien après la mort, alors pourquoi se fatiguer à vivre? L’ennui de ma vie m’épuisait, alors autant y mettre fin tout de suite, si la mort est inéluctable et la vie fatigante. Logique mais pas certain. La Voix en moi, encore lointaine, me soufflait que la réponse était ailleurs.
Je me suis alors demandé si vraiment, il n’y avait rien après la mort. J’ai trouvé des réponses, celles à tiroirs, celles qui amènent d’autres questions. Ça, c’était amusant et le plaisir a balayé l’ennui. Certaines de ces réponses sont devenues mes certitudes. Les miennes, que je partage sans les imposer, car il n’y a rien de moins certain qu’une certitude. Je les conserve, parce qu’elles me tiennent chaud et surtout, elles me maintiennent en vie.
Je suis convaincue, par exemple, qu’il y a un ordre des choses qui fonctionne logiquement. Je cherche toujours la logique. Et je trouve, parce que quand on cherche, on trouve. Parfois, je tombe sur du vide, du rien. Mais le rien, c’est quelque chose, comme disait l’autre. Parfois, la logique des choses n’est pas à notre portée car nous n’avons pas tous les paramètres à disposition. C’est là que l’humilité est nécessaire.
J’ai compris aussi qu’on ne peut pas tout comprendre. Question de cerveau. La vie n’est pas seulement ce que nos cinq sens plutôt atrophiés peuvent en capter, même si on leur ajoute quelque micro ou macroscope de haute technologie. Plus on découvre, plus il y a à découvrir, c’est bien connu. J’ai adoré comprendre cela.
Un truc énorme est arrivé avec la compréhension, c’est la responsabilité. À comprendre les rouages de la vie, la portée de mes actes, je ne peux plus dire «je ne savais pas». Pourtant, certains jours, il ferait bon retourner dans le nid douillet de l’inconscience.
On m’a souvent reproché :
—Tu réfléchis trop! T’es une mentale.
Je l’aime bien, ce dernier. Ils ne le savent pas, mais je le prends comme un compliment. Oui, j’utilise mon mental pour prendre conscience, pour comprendre, pour englober, pour tomber sur les limites et les dépasser. Et ce matin, à visionner mes youtubes en retard, manifestement, je ne suis pas seule à me poser ces grandes questions. Je ne suis pas seule à penser que notre monde est bizarre, que nous vivons dans une illusion. Celle, entre autres, que le bonheur, c’est le dollar. Ça, c’est la plus grande farce qu’on nous joue en ce début de IIIe millénaire. Ça fait des décennies qu’on nous la joue, cette farce, et vraiment, je ne la trouve pas drôle. Sûrement parce que pour la jouer, il faudrait que je me laisse pousser les dents et les pieds pour que les premières rayent le parquet et les seconds écrasent ceux des autres. Mais ça aussi, c’est sûrement une illusion.
Ce qui ne l’est pas, c’est que même si j’aime le confort et le luxe, jamais l’argent n’étanchera en moi ce qui a soif. Un jour de catéchisme de mon enfance, j’ai entendu deux mots magiques: «paradis terrestre». Ensuite, on m’a dit qu’il se trouvait au ciel, après la mort. Il faudrait savoir, terrestre ou céleste, le paradis? Dans cet oasis magnifique, Adam et Eve, les amants merveilleux et nus, vivant d’amour et d’eau fraîche. J’ai bien aimé l’idée. Ils procréèrent deux rejetons, un gentil, Abel, un méchant, Caïn. Là, j’ai commencé à ne plus l’aimer, cette histoire. Mais admettons. Ensuite, c’est devenu franchement foutage de gueule, même pour une gamine de huit ans. Non seulement, cette famille-là serait à l’origine de toute l’humanité — une bande de bâtards forniquant entre eux, soit dit en passant — mais ensuite, il est question de pommier empoisonné par un serpent, de vilaine sorcière, de sept nains… Ah non, pardon, je dois mélanger les légendes.
Le thermomètre indique 38,8° de fièvre, je devrais boire quelque chose et surveiller mon langage. Peu importe, je continue.
Ce sont des questions d’il y a longtemps, mais elles m’énervent encore. Ces deux derniers jours, au fond de mon lit, c’est David Icke qui ouvre une brèche supplémentaire et augmente ma fièvre. Ça faisait longtemps que je n’avais pas questionné la vie, je ne me rappelais plus comment j’aimais cela, questionner. David Icke croise souvent mon chemin. Au début, je le trouvais vraiment frapadingue et ce qu’il disait me faisait peur. Et puis il y a eu Laura Knight et ses Cassiopéens. J’ai eu encore plus peur. Tous deux parlent de prédateurs de l’humanité, tout comme Castaneda, d’ailleurs, d’un genre extra-terrestre reptilien. —Tiens, tiens, le serpent de la pomme? Des histoires tellement énormes que je les ai étiquetées «folles, à consommer avec précaution». Je me suis dit toute seule, pour une fois, qu’il fallait raison garder.
Oui, mais justement, c’est la raison qui nous maintient en prison. C’est elle qui décourage les réponses aux questions les plus ajustées. «C’est de la folie» n’est pas une réponse, c’est une indication. D’un autre côté, quand je vois comment rien qu’un peu de bonne volonté change les choses, je suis fascinée par les humains que nous pouvons être. Alors pourquoi ne l’utilisons-nous pas, cette bonne volonté? Pourquoi tous les justes sont-ils holocaustés? Gandhi, Martin Luther King, John Lennon qui «imagine tous les gens, avançant comme un seul, main dans la main». On les fait taire, pourquoi? Qui ne veut pas d’eux? Pas moi.
Les réponses font frissonner. Prendre conscience de tout cela me paraît crucial. J’aimerais trouver les mots pour convaincre les autres que «la vie, c’est pas ça». Le paradis, je suis sûre qu’on peut le créer terrestre. Il faudrait qu’on s’y mette ensemble, ça vous dirait pas? Mon mental surchauffe et je ne sais pas si c’est lui qui cause la fièvre ou si c’est la fièvre qui fait tourner les grandes questions en boucle, mélangeant tout et me déconnectant une fois de plus de mon écriture.
Je prends une double ration d’aspirine, parce que je vais y retourner, à mon roman. Demain, juré, après une bonne nuit de sommeil.
Trois jours plus tard, la révolte est toujours là. Obsessionnelle. Je me sens impuissante à changer le monde toute seule, et j’ai beau changer la mienne, il me semble que dehors, les choses empirent. Je dépends des autres. Ah non, je n’aime pas cette idée, et je suis sûre qu’elle est fausse. N’empêche qu’une conviction s’installe en moi que collectivement, nous pourrions faire basculer les choses. Et il y a un feu dans mes tripes qui a besoin de trouver comment donner aux autres envie de changer les choses. J’y crois tellement que je ne sens capable de le faire. «On a tout essayé sauf l’amour». Ça ne vous tente pas?
Bon, là, ça devient pathologique. Je me fais un café fort, je secoue mes neurones, et j’attrape la page blanche où les mariés sont en train de s’étioler en voyage de noces. C’est le moment de les réanimer et d’inventer la suite de l’histoire.
Au travail ! Discipline et persévérance.